Aujourd’hui encore, il fait une chaleur accablante. Le thermomètre marque 36° mais à la surface de l’eau, il doit faire 45.
Il y a neuf jours, j’entamais à Maripasoula, la descente à la nage du fleuve Maroni, frontière naturelle entre le département de la Guyane et le Surinam. Une expédition qui s’est avérée dès le départ, plus difficile que prévue en raison du niveau de l’eau, le plus bas depuis vingt ans, résultat d’une sécheresse dont personne ne voit le bout. Dans le canoë d’assistance, David et Gilles, mes deux compagnons, transpirent à grosses gouttes. Ils ont du mal à m’indiquer les meilleurs passages tant les rochers qui ponctuent le cours du fleuve sont nombreux.
Sans cesse, je dois arrêter de nager pour éviter un nouvel obstacle. L’hydrospeed, planche de polystyrène, que je comptais utiliser pour le passage des rapides me sert trop souvent, pour des zones ou les pierres sont à fleur d’eau. Les quinze à vingt kilomètres que je réalise chaque jour, alternant le crawl classique et le palmage avec l’hydro, sont de ce fait assez éprouvants dans un fleuve où la température est proche de celle d’un Jaccuzzi.
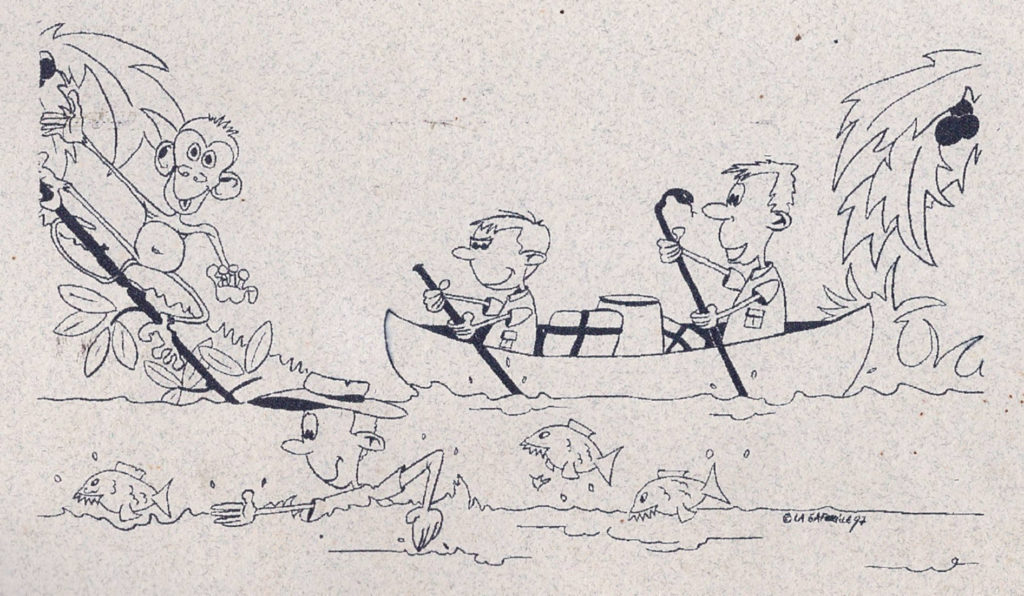
Nous sommes en milieu d’après-midi quand je demande à David et Gilles de quoi boire. Chaque matin, à l’aide d’une petite pompe, ils filtrent l’eau du fleuve dans des bouteilles. Nous y ajoutons ensuite du sirop ou des produits énergétiques. Devant nous, un nouvel obstacle, différent des précédents. En effet, au lieu d’un rapide simple, il est une succession de sauts irréguliers de longueurs différentes.
Accroché à l’hydrospeed, je me lance dans le courant, rattrapé par le canoë d’assistance. Les sauts s’enchaînent rapidement, séparés entre eux par quelques dizaines de mètres d’eau calme. A proximité du tout dernier, des bruits de moteurs se font entendre. Au loin, nous apercevons cinq ou six pirogues et autour d’elles, une certaine effervescence.
Sur le Maroni, le ravitaillement se fait grâce à ces pirogues immenses, pilotés par les Bonis ou des Djukas qui connaissent le fleuve comme leur poche. Si le remonter à la saison des pluies ne représente pas de difficultés particulières, à cette époque de l’année et avec une eau aussi basse, c’est un véritable parcours du combattant. Il faut normalement trois jours pour rejoindre Maripasoula de Saint-Laurent-du Maroni, sept à dix jours en ce moment malgré la puissance des moteurs. Le simple passage d’un saut peut demander une demi-journée, le temps de décharger les deux ou trois tonnes de matériel transporté et de les recharger.
Sur ce rapide, Mendessi soula, un seul passage possible pour les pirogues qui remontent. Les unes derrière les autres, elles attendent leur tour. Les unes derrière les autres, elles attendent leur tour. De l’eau jusqu’à la taille, les muscles gonflés par l’effort, les piroguiers tentent de faire passer l’une d’entre elles. A son bord, deux femmes et un jeune enfant, inquiets, tant l’issue semble encore incertaine. A l’arrière, le motoriste pousse son moteur de 65 chevaux à plein régime. Quand l’embarcation avance un peu, profitant de son inertie, il lève le moteur pour protéger l’hélice qui continue à gronder dans un nuage d’éclaboussures. Sortis du bateau, mes équipiers se joignent au groupe et se mettent à leur tour à pousser la longue pirogue qui finit par passer. Alors que je sors de l’eau, David s’approche de moi, la main dégoulinante de sang. Sur le côté de l’embarcation, son pouce à glissé sur un morceau de tôle acéré. Il saigne abondamment, serre les dents. De notre trousse de secours, nous sortons de quoi lui faire un pansement mais sa blessure semble nécessiter des points de suture.
La commune de Grand Santi n’est plus qu’à une vingtaine de kilomètres. Aucune chance d’y arriver avant demain après-midi. Je décide alors d’arrêter une pirogue pour nous y accompagner. Nous reviendrons ici une fois David soigné. Malheureusement, la nuit s’approche à grands pas et depuis notre arrivée dans le rapide il y a plus d’une heure, nous n’avons été rejoints par aucune embarcation. Nous déposons David sur un banc de sable avant de regagner la berge du Surinam où est accostée une pirogue motorisée. Après avoir trouvé son propriétaire, Gilles et moi tentons de le décider de nous conduire à Grand Santi. La discussion se prolonge pour définir le prix. Il nous demande 500 francs pour les vingt kilomètres nous séparant de la commune, le double pour lui, avec le retour. C’est vrai, le carburant est très cher et cela l’oblige à rentrer de nuit. Nous tombons d’accord sur 400 francs et un Walkman quand une pirogue qui descend s’approche de nous. Tout aussi satisfaits que notre homme, nous lui faisons signe. Il s’agit de l’embarcation de la Poste qui, deux fois par semaine, achemine le courrier dans les villages du Maroni. Ils acceptent immédiatement de nous prendre tous les trois à bord avec notre Canoë.
Comme l’an passé, alors que je remontais le fleuve en pirogue, j’admire l’adresse du motoriste, scrutant à la surface de l’eau, la moindre ride annonciatrice de la présence d’un rocher. A l’avant, le «takariste» sonde le fond avec une perche de bois et annonce, par petits signes, le passage le plus propice. Le soleil disparaît derrière les grands arbres quand nous arrivons à Grand Santi. David et Gilles partent à la recherche du médecin de la commune pendant que je rassemble notre matériel sur la berge. Curieux, des enfants torses nu se rassemblent autour de moi. Une trentaine de minutes plus tard, mes compagnons reviennent. David a la main bandée et la mine encore pâle.
C’est chez Madame Elisabeth que nous installons nos hamacs. D’origine Martiniquaise, elle partage son temps entre Grand Santi et son île des Antilles où elle retourne régulièrement retrouver ses nombreux enfants. Ici, elle dirige le seul restaurant de la commune où elle sert une petite dizaine de repas par semaine. Tania est Brésilienne, l’aide à la cuisine et fait chaque matin un pain délicieux. C’est là qu’un peu plus tard dans la soirée, je vais vider plus d’un litre et demi de boisson sucrée et engloutir trois sandwiches.
Nous décidons de nous accorder une journée de repos. La blessure de David doit éviter l’eau et Gilles et moi souhaitons nous rendre au dispensaire pour des douleurs aux oreilles. Nous remettons un peu d’ordre dans notre matériel, faisons l’inventaire alors que David montre des signes évidents de fatigue. Avec un peu de mal, nous l’aidons à marcher jusqu’au dispensaire, distant d’environ 500 mètres. Une analyse sanguine le déclare porteur du paludisme. Une maladie résultant de la piqûre d’un moustique femelle, sans trop de gravité si le traitement est commencé à temps. Dans le cas contraire, l’issue est bien souvent fatale. Dans les pays peu médicalisés c’est un véritable fléau ayant le triste honneur de caracoler en tête du nombre de décès par an chez les enfants, plus de 2,5 millions, principalement en Afrique.
L’année dernière, j’avais ramené de Guyane ce virus dans mes bagages. Résultat, six jours d’hôpital et un bon moment avant de retrouver la forme. Notre ami a tous les symptômes : fièvre, fatigue, maux de crâne, courbatures ; il s’endort dans le canoë. Alors que la nuit tombe, Gilles et moi, assis par terre, faisons le point sur la situation. La première partie du traitement ayant été prise à temps, il peut être sur pieds dans trois jours. Si ce n’est pas le cas, nous poursuivrons l’expédition à deux, le laissant regagner la métropole pour se reposer.
Au petit matin, son état ne s’est guère amélioré. Devant sa tasse de thé, il a du mal à garder les yeux ouverts. Les coudes sur la table, son visage entre les mains, il s’endort. Avec peine, nous l’installons de nouveau dans le bateau, sans qu’il ne s’éveille. Nous tuons le temps au bord du fleuve, une ligne de pêche dans l’eau quand Elisabeth vient nous chercher. David nous demande. Lorsque nous parvenons à ses cotés, il est assis, amorphe. Sur ses joues, de grosses larmes perlent. En des paroles incohérentes, il m’exprime son désespoir, son ras le bol et son désir de rentrer en métropole. Entre deux sanglots, il parle de sa femme qu’il souhaite retrouver au plus vite. L’état de déprime passager résulte parfois du paludisme et nous mettons ce moment de terrible passage à vide sur le compte de la maladie. Avec des paroles réconfortantes mais fermes, nous tentons de lui remonter le moral et de l’inciter à se reprendre. Nous lui annonçons notre décision de continuer à deux et il pourra de ce fait, regagner Paris dès que ce sera possible. En quelques minutes, il s’affaiblit considérablement et finit par s’allonger de nouveau. Gilles part chercher le médecin qui met beaucoup de temps à arriver. Sur la remorque de son quad, une moto à quatre roues, nous installons le canoë dans lequel David se trouve toujours. Au dispensaire, nous avons un mal fou à l’allonger sur la table d’examen. Il est inconscient.
Rapidement, Nicolas, le médecin, rejoint par un autre docteur et trois infirmières, effectue un bilan général. David ne répond pas aux questions, n’a plus de réflexes et plus aucune réaction à la douleur. Une pointe en métal déplacée du bas en haut de ses pieds ne le fait pas bouger d’un pouce, pas plus qu’un fort pincement sur la poitrine. Du regard, je cherche sur les visages un signe d’optimisme que je ne parviens pas à déceler. Mon cœur bat la chamade.
Il est 11 h 30, Nicolas décide de le faire évacuer sur Cayenne par hélicoptère.
Alors que Gilles n’est pas près de moi, je veux savoir et interroge Nicolas, même si la réponse semble évidente.
- Comment cela se présente ?
- Mal ! me répond-il.
Après quelques examens complémentaires et alors que je souhaite en savoir plus, il m’annonce qu’il estime ses chances de s’en sortir à environ une sur cinq. J’avale ma salive.
Dans la petite pièce adjacente à la salle d’examen, je fais les cent pas. Dehors, John, qui effectue les analyses sanguines est venu aux nouvelles. En voyant son paquet de cigarettes, je lui en demande une, puis une autre, et une autre encore.
L’hélicoptère tarde, il est parti dans une autre commune et doit repasser par Cayenne avant de venir à nous. Les minutes durent des heures, pas d’amélioration, j’ai l’impression de voir la mort rôder dans la pièce. David est allongé sur le côté, en position latérale de sécurité, dans le bras la perfusion et sur son torse nu des capteurs, reliés à un électrocardiogramme. Du service de réanimation de l’hôpital de Cayenne arrive un fax. Il indique en fonction des réactions éventuelles, les différents niveaux de coma. Pour notre ami, le dernier stade !
Je pense à sa femme avec qui il est marié depuis tout juste un mois, au bébé qu’elle attend, à ses parents et à la manière dont je devrais leur annoncer la nouvelle, le cas échéant. Je m’imagine au téléphone pour leur demander de venir. Aurai-je le courage de leur dire tout de suite ? Je tente de comprendre et évalue mes responsabilités. J’ai conscience de n’y être pour rien, d’avoir tout fait pour que la sécurité soit assurée au maximum et pourtant, sans moi, à cette heure, il serait chez lui. Et l’hélicoptère qui n’arrive pas. Jamais, les minutes n’ont mis autant de temps à s’égrener. Curieusement, je suis pessimiste alors que je trouve toujours d’habitude une bonne raison de garder le sourire. Je me dis que quoi qu’il arrive, il n’en sortira pas indemne, que le coma aura touché son cerveau ou une autre de ses fonctions vitales.
Gilles garde son calme. Il ne parle pas, attend patiemment. Pas question bien entendu de poursuivre l’expédition pour l’instant. Je décide malgré le prix très élevé, de tenter de faire venir de Cayenne un avion privé. Ce, afin que nous soyons à ses côtés à l’hôpital dès ce soir. Malheureusement, aucun n’est disponible.
Il est 15h30. Au loin, je perçois enfin le son régulier du rotor. Dans la salle du dispensaire, David est toujours à la même place, mais l’optimisme flotte dans l’air. Il y a quelques minutes, l’une des infirmières qui lui tenait la main a senti ses doigts bouger. Rien depuis, mais tous ont repris espoir.
Tout de blanc vêtu, le jeune réanimateur du SAMU prend connaissance des données recueillies par l’équipe médicale. Avec son assistante, ils déplacent la perfusion et gonflent le matelas coquille. Nous aidons à l’installer et à le transporter jusqu’à l’hélicoptère. Quand l’appareil décolle, nous savons qu’il est dans les meilleures mains possibles et qu’il n’y a plus qu’à espérer. A la nuit tombée, je téléphone à l’hôpital où l’on m’annonce qu’il est sorti du coma, mais qu’il est pour l’instant impossible de se prononcer avant l’arrivée des résultats. Au petit matin, les nouvelles sont meilleures même si personne à Cayenne, ne semble capable d’expliquer l’origine du mal.
Après une dizaine d’heures de pirogue, une nuit dans la ville de Saint-Laurent-du-Maroni et quelques heures de route, nous arrivons au service de réanimation où notre ami se trouve. La surprise est totale, non seulement il semble en forme, mais il peut sortir. Son mal reste un mystère.
Deux jours plus tard, Gilles et moi avons retrouvé le fleuve pour la fin de l’expédition, David lui, a regagné la métropole. L’aventure aurait pu tourner au drame mais l’aventure, cela peut aussi être cela, faire face à des situations totalement imprévisibles. Des situations auxquelles on accepte d’être confronté, pour vivre cette passion jusqu’au bout.
